
Publié le 16 mars 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Depuis le 16 mars 2022, les hommes ayant des relations homosexuelles ne sont plus tenus de respecter une période d'abstinence pour pouvoir donner leur sang.
Un arrêté publié au Journal officiel du 13 janvier 2022 supprime toute référence au genre des partenaires sexuels dans la sélection des candidats au don. Cette décision s'inscrit dans le prolongement de la loi bioéthique et rend le don du sang accessible à tous sur la base des mêmes critères.
Des dons soumis à une période d'abstinence sexuelle depuis 2016
De 1983 à 2016, le don du sang était interdit aux hommes homosexuels. La loi a changé en juillet 2016, leur permettant de donner leur sang, mais cette possibilité restait soumise jusqu'ici à une période d'abstinence sexuelle d'abord fixée à un an, avant d'être ramenée en 2019 à quatre mois. Celle-ci devait être déclarée lors de l'entretien préalable.
Ce qui change concrètement ?
Depuis le 16 mars 2022, il n'y a « plus aucune référence à l'orientation sexuelle », dans les questionnaires préalables au don du sang distribués par l’Établissement français du sang (EFS).
Cependant, un nouveau critère est ajouté
le donneur devra déclarer s'il prend un traitement pour la prophylaxie pré ou post-exposition au VIH, auquel cas le don sera reporté quatre mois plus tard. Le questionnaire permet également d'identifier des comportements à risque, incompatibles avec un don du sang (multipartenaires, consommation de drogues...), mais l'orientation sexuelle n'est plus mentionnée.
À noter : L'entrée en vigueur deux mois après la publication deux mois vise à tenir « compte de la nécessité de former les préleveurs et d'adapter les différents documents liés au recueil des informations, dont le nouveau questionnaire ».
Rappel : La loi du 2 août 2021 sur la bioéthique avait prévu que les dons de sang « ne peuvent être fondés sur aucune différence de traitement, notamment en ce qui concerne le sexe des partenaires avec lesquels les donneurs auraient entretenu des relations sexuelles, non justifiée par la nécessité de protéger le donneur ou le receveur » (article 12, article L. 1211-6-1 du Code de la santé publique). Elle ajoutait que « les critères sont régulièrement révisés pour tenir compte notamment de l'évolution des connaissances, des dispositifs de sécurisation et des risques sanitaires
Le don du sang ouvert aux homosexuels dès le printemps 2016
Bonjour, je tiens à aborder ce délicat sujet.
Suite à une rencontre et la discussion qui en a suivie sur l'édition 2017 de "Vive la rentrée à la filature",
mais aussi pour des amis qui m'ont questionné sur le sujet amicalement sylvain.
L'exclusion permanente des dons du sang des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes avait été instituée en 1983 en raison des risques liés au virus du sida.
"Donner son sang est un acte de générosité, de citoyenneté, qui ne peut être conditionné à une orientation sexuelle. Dans le respect de la sécurité absolue des patients, c'est aujourd'hui un tabou, une discrimination qui sont levés", a déclaré la ministre en présentant les mesures destinées à mettre fin à cette exclusion, mercredi 4 novembre 2015, aux associations concernées.
Marisol Touraine s'était engagée dès 2012 à revenir sur cette interdiction, conformément à la promesse faite par François Hollande avant la présidentielle. Pour garantir la sécurité des receveurs, cette "ouverture" se fera "par étapes", a indiqué la ministre. La première, au printemps 2016, marquera la fin de l'exclusion permanente du don.
A partir de cette date, le "don de sang total" - la forme de don la plus courante où toutes les composantes du sang (cellules et plasma) sont prélevées sera ouvert aux hommes qui n'auront pas eu de relations homosexuelles depuis douze mois, après un questionnaire et un entretien - .
"Cette décision garantit la sécurité du don du sang", a souligné Marisol Touraine qui veut "rassurer les receveurs". Le Dr Benoit Vallet, directeur général de la santé, a précisé que "le risque sera tout à fait comparable" à celui qui existe aujourd'hui. Dans le système actuel, dix à quinze donneurs sont diagnostiqués séropositifs chaque année, soit un risque "résiduel" de l'ordre de 1 pour 3.500.000 dons. Mais le dernier cas de contamination d'un receveur date d'il y a 13 ans.
Autre révolution : toujours à partir du printemps 2016, les hommes qui, au cours des quatre derniers mois, n'ont pas eu de relation homosexuelle ou ont eu un seul partenaire, pourront donner leur plasma, grâce à la création d'une filière sécurisée où il sera mis en quarantaine pendant deux mois et demi environ pour s'assurer de son innocuité.on refait des tests sur le patient qui revient au centre. S’il est négatif aux tests sérologiques, le don est mis dans le circuit des malades, il est forcément sain.
Cette filière sécurisée va, en outre, permettre aux autorités sanitaires de mener une étude sur le terrain sur ces nouveaux donneurs. Si cette étude démontre qu'il n'y a pas de risques, les règles du don du sang pour les homosexuels (ou les hommes ayant eu au moins un rapport avec un autre homme), se rapprocheront des règles générales appliquées aux autres donneurs. Cette deuxième étape interviendrait en 2017, précise le ministère.
La fin de l'exclusion des homosexuels permettra d'avoir 21.000 donneurs supplémentaires, soit 37.000 dons de plus (sur la base de trois dons en moyenne par an et par donneur), selon M. Vallet.
En optant pour un délai de 12 mois, la France "s'aligne sur la plupart des pays" qui ont abandonné le système d'exclusion des homosexuels, a fait valoir Marisol Touraine, citant notamment le cas des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et de l'Australie. La Direction générale de la santé rappelle que dans ces pays, on n'a pas constaté d'augmentation du risque de transmission du virus du sida lors des transfusions.

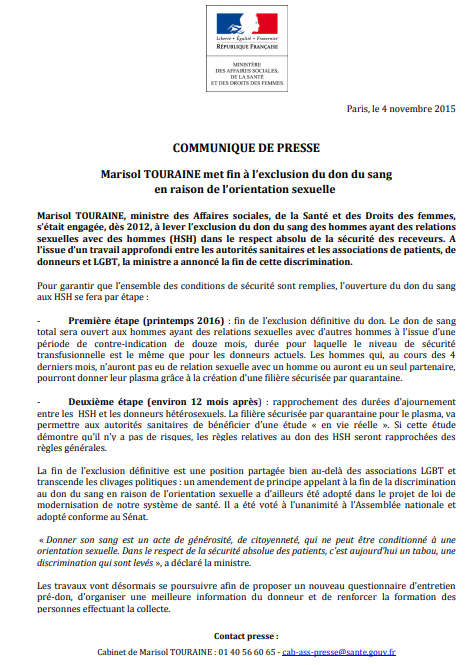
« Le don du sang n’est pas un droit », selon le président de Aides
Pour Aurélien Beaucamp, la prévalence du sida dans la population homosexuelle explique la période d’abstinence sexuelle exigée avant un don.
Aujourd’hui, sur le front du sida, l’épidémie est forte chez les homosexuels, avec un nombre de nouveaux cas très élevé. Ainsi, chez ceux fréquentant des lieux sexuels, une incidence (nombre de nouveaux cas par an) de 4% est constatée, ce qui est énorme. Or, les tests actuels de recherche du virus ont toujours une fenêtre d’incertitude, il y a quelques jours de battement entre le moment de la contamination et celui de la détection par les tests. Donc, si durant cet intervalle la personne donne son sang, il y a une probabilité de ne pas s’en apercevoir. «Le risque existe, note une épidémiologiste de renom. C’est pour cela que les gays sont exclus du don de sang.» «Discrimination», «homophobie»,rétorquent certains, qui mettent en avant que le risque ne réside pas dans le fait d’être homosexuel, mais dans celui d’être à partenaires multiples, homos ou hétéros.
Virus du sida, hépatite, syphilis ou encore paludisme : ces maladies peuvent toutes être transmises par le sang. En 2014, l’Etablissement Français du Sang (EFS) enregistrait 1,8 million de donneurs. Alors pour chaque poche de sang recueillie, un protocole très strict est déjà appliqué.
 Première étape : le donneur passe un entretien et répond à un questionnaire précis. "Ces questions concernent les rapports sexuels à risques, les partenaires à risques, la toxicomanie par voie intraveineuse… On pose des questions très spécifiques", détaille Geneviève Woimant, médecin généraliste à l'Etablissement Français du Sang. L'EFS fait donc appel à la bonne foi des donneurs, pour déterminer s’ils risquent de transmettre une maladie.
Première étape : le donneur passe un entretien et répond à un questionnaire précis. "Ces questions concernent les rapports sexuels à risques, les partenaires à risques, la toxicomanie par voie intraveineuse… On pose des questions très spécifiques", détaille Geneviève Woimant, médecin généraliste à l'Etablissement Français du Sang. L'EFS fait donc appel à la bonne foi des donneurs, pour déterminer s’ils risquent de transmettre une maladie.
L'étape suivante consiste à effectuer une série de tests biologiques, pour vérifier la sécurité infectieuse du sang. Mais un risque résiduel persiste. Pour le VIH par exemple, il est de 1 sur 3,5 millions de dons. "La sécurité est maximale, mais il n'y a pas de risque zéro", poursuit Geneviève Woimant. On fait des tests sur toutes les poches de sang prélevées, et on applique cette sécurité lors de la sélection des donneurs. On ne peut pas être à 100% garants, car il existe ce qu'on appelle une "fenêtre sérologique" : après une infection par le VIH, il y a 12 jours où l'infection existe, mais on ne peut pas la dépister.